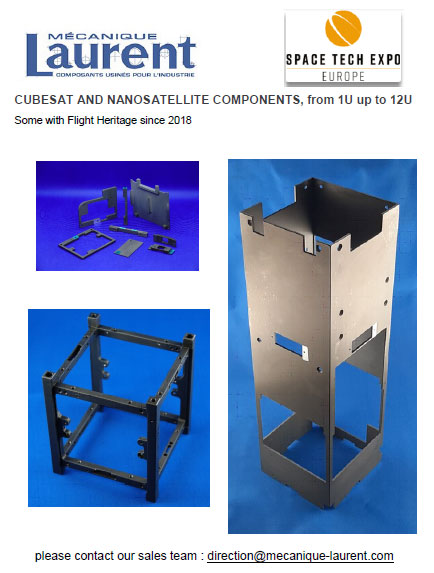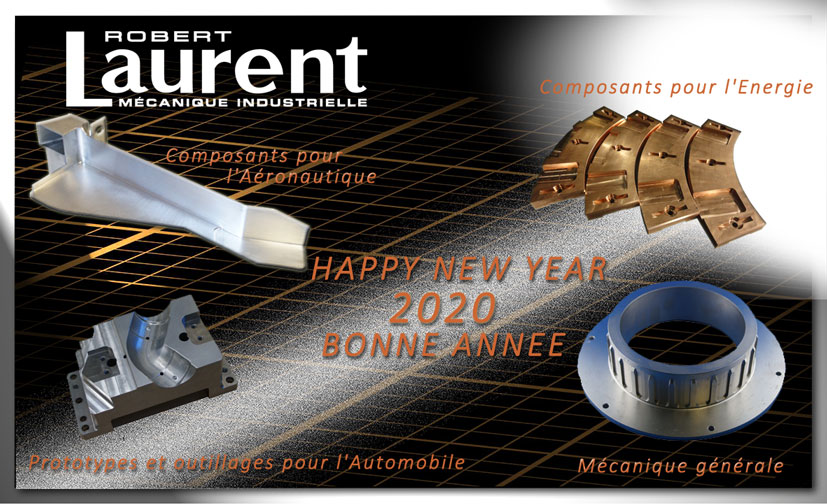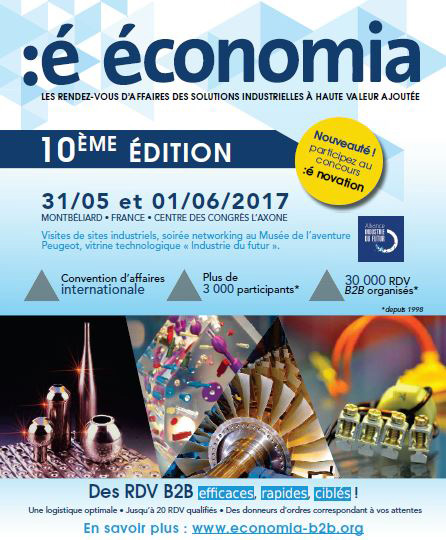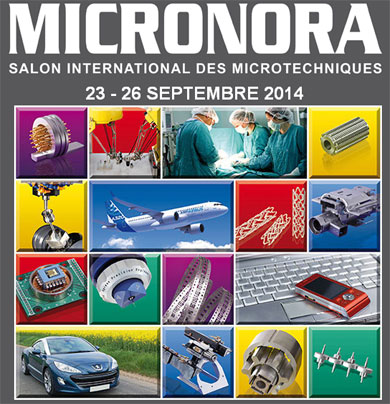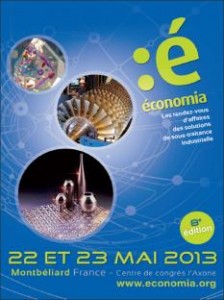Article Les Echos Publié le 14/01/2025
En moins d'un an, les sociétés Latitude, Unseenlabs, The Exploration Company et Loft Orbital ont toutes signé un gros tour de table. Les deux dernières ont la particularité de se développer à cheval entre plusieurs pays.
Il y a eu du retard à l'allumage. Mais l'écosystème français du New Space connaît un décollage financier spectaculaire. En moins d'un an, quatre start-up ont réalisé des tours de table importants.
Latitude, concepteur d'un mini-lanceur, a ouvert le bal avec un financement de 27 millions d'euros en janvier 2024 ; Unseenlabs, spécialiste de la géolocalisation radiofréquence, a embrayé en février dernier avec une levée de fonds de 85 millions d'euros ; The Exploration Company, qui développe une capsule spatiale réutilisable, a signé la plus grosse série B en Europe en novembre 2024 (150 millions d'euros). Quant à Loft Orbital, elle vient de signer un tour de table de 170 millions d'euros qui en fait une licorne.
Des projets binationaux
Le spatial est un secteur gourmand en cash et où les projets se jouent des frontières. Si Unseenlabs est implanté à Rennes et Latitude s'épanouit à Reims, The Exploration Company et Loft Orbital sont des projets internationaux.
Le premier se développe entre Bordeaux et Munich ; le second a été fondé à San Francisco par une équipe franco-américaine (Pierre-Damien Vaujour, Alex Greenberg et Antoine de Chassy), mais dispose d'une grosse équipe en Occitanie, la région historique du spatial dans l'Hexagone, ainsi qu'à Abou Dabi.
Cette nouvelle donne « reflète la maturité du spatial français et sa capacité à engranger des commandes, même s'il reste un long chemin à parcourir », explique Maxime Puteaux, consultant au cabinet Novaspace. Dans leur sillage, d'autres projets ambitieux se montent et appâtent les investisseurs, à l'image de Constellation Technologies & Operations, Ion-X ou encore Infinite Orbits, rappelle-t-il.
Amélioration du financement
Ces dernières années, l'écosystème de financement en phase d'amorçage a pris de l'épaisseur, avec des fonds spécialisés comme Expansion ou Cosmicapital (géré par Karista). Mais il était plus difficile de trouver des gros investisseurs privés lors des étapes suivantes (série B, C, D).
Cela commence à changer. Le dernier tour de table de Loft Orbital a été mené par le fonds français Tikehau Capital. Supernova a aussi participé à l'opération. « Loft Orbital est en train de réussir le pari de se réeuropéaniser », salue Pierre Bertrand, fondateur de Skynopy (solution de connectivité des satellites) et ancien de Loft Orbital. Le dernier financement de The Exploration Company a, lui, été dirigé par Balderton Capital et Plural, deux gros fonds d'investissement européens.
La guerre en Ukraine et les succès insolents de SpaceX ont été des déclics. « Pour des raisons géostratégiques, l'Europe a pris conscience qu'il fallait se doter de services spatiaux sur son sol », observe Alexandre Mordacq, investisseur chez 360 Capital.
L'Etat français participe à cette dynamique, puisqu'il est au capital de ces quatre sociétés (via différents véhicules de Bpifrance) et a fléché de l'argent vers le New Space à travers le plan France 2030. Dans le cadre d'un appel à projets, Latitude a, par exemple, obtenu 15 millions d'euros en juin dernier.
Pas toutes au même stade
Toutes ces sociétés n'en sont pas au même stade. Latitude est encore en phase de R&D et doit réaliser le premier lancement de son micro-lanceur Zéphyr en 2025. Idem pour The Exploration Company avec sa capsule de taille moyenne (Mission Possible), qui doit dérisquer ses technologies en vue du lancement de sa capsule réutilisable (Nyx) en 2028.
« Ces sociétés jouent le rôle d'éclaireurs. Les investisseurs vont regarder avec attention comment elles vont performer », décrypte Maxime Puteaux. Leur réussite (ou leur échec) déterminera, dans le futur, des nouveaux financements.
A l'inverse, Unseenlabs et Loft Orbital sont opérationnels et génèrent des revenus croissants. « Unseenlabs est rentable, mais c'est plus l'exception que la règle dans le spatial », avance Alexandre Mordacq. Loft Orbital ne communique pas sur son chiffre d'affaires mais assure avoir 500 millions de contrats signés. De quoi aborder l'avenir avec sérénité.